|
Thérèse
Boutinon des Hayes |
|
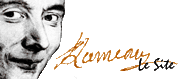
"to hide art by very art"
"cacher l'art par l'art même"
|
Thérèse
Boutinon était la fille de Samuel Boutinon des Hayes, ancien
lieutenant des Dragons du roi de Danemark, mais resté sans
emploi à son retour en France (des Hayes était protestant,
ce qui nuisit à sa carrière) et de Marie-Anne-Michelle Carton-Dancourt,
dite Mimi Dancourt, actrice de la Comédie française. |
|
Mon
coeur, mon sang est encore d'une agitation la plus vive.
Je suis d'une sensibilité et d'une vivacité à me jeter par
la fenêtre... Mon imagination est toujours en mouvement.
Ce sont des projets, des craintes, des langueurs, des fureurs ;
je suis folle !... Cet animal [La Pouplinière] l'autre jour
disoit : "Votre frère est heureux, il n'a que
les ondulations de la sensibilité, il n'en a pas les vagues.
Ah, c'est bien moi qui les ai, ces chiennes de vagues !" Je
ne désire jamais foiblement jusqu'à un verre d'orgeat, mais
je m'en passe quand j'y vois la moindre difficulté et ma
vie en est tissue, je ne me rebutte pas si facilement pour
tout : il y en a qui m'obstine et que je surmonteray
ou j'y moureray. Je
lus, il y a un mois, le petit extrait que Melle Deshayes
avait fait de l'ouvrage de l'Euclide-Orphée et je dis à
Mme du Châtelet : je suis sûr qu'avant qu'il soit peu
Pollion (La Pouplinière) épousera cette muse là. Il y avait
dans ces trois ou quatre pages une sorte de mérite peu commun ;
et tout cela joint à tant de talents et de grâce, fait en
tout une personne si respectable qu'il était impossible
de ne pas mettre tout son bonheur et toute sa gloire à l'épouser.
Que leur bonheur soit public, mon cher ami, et que mes compliments
soient bien secrets, je vous en conjure. Je souhaite que
l'on se souvienne de moi dans votre temple des Muses." J'ai
été plongé dans les plus grandes douleurs, mon illustre
ami, et je suis toujours dans l'affliction ; j'ai perdu
le 22 du mois dernier madame de la Popelinière que j'aimais
de tout mon coeur et à qui j'avais bien des obligations,
elle méritait de survivre à ses malheurs ; c'étoit une femme
rare et qui dans quelque rang de la société qu'elle eut
été placée se seroit fait distinguer et considérer, elle
est regrettée généralement de tous ceux tant hommes que
femmes qui avaient le bonheur de la connaître ; elle
aimait à rendre service et à faire du bien sans aucune ostentation,
il est incroyable combien elle y était ingénieuse et habile
; elle me dit quelques jours avant sa mort qu'elle me laisserait
une marque de mon amitié, qu'elle se le devait à elle-même
autant qu'à moi ; je ne sais encore ce que c'est, on
en a parlé sans moi avec M. de la Popelinière qui a répondu
qu'il y aurait égard et que quand il n'y aurait rien d'écrit,
il savait ses intentions ; j'ai reçu de lui une lettre
tout à fait touchante et je viens de passer quelques jours
chez lui où j'ai excité ses pleurs et ses regrets par les
miens..." |
|
Bibliographie : Georges CUCUEL, La Pouplinière et la musique de chambre au XVIIIe siècle, Fischbacher, 1913, réimprimé par Da Capo, New York, 1971. Georges CUCUEL, "Les Dernières années de Madame de la Pouplinière", Revue de Paris, mars-avril 1912, année 19, T.2. |

