|
Réponse
à messieurs les éditeurs de l'Encyclopédie
à propos de leur dernier avertissement Jean-Philippe
Rameau |
|
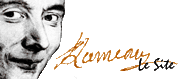
"to hide art by very art"
"cacher l'art par l'art même"
|
J'expose d'abord ces Avertissements pour la commodité du Lecteur. Tout ce qui s'y trouve en italiques se trouve de même dans la Réponse, pour que les citations se présentent plus promptement à l'oeil. Du
6e tome de L'Encyclopédie. "Je crois, dit-il, devoir mettre des Editeurs de l'Encyclopédie sur la voie des vérités qu'ils ignorent, négligent, ou dissimulent, pour y substituer des erreurs, & MEME, des opinions." La déclaration que nous venons de faire doit nous mettre à l'abri d'une accusation hasardée. Du reste, l'Auteur ne doit point regarder cette déclaration comme un aveu tacite ou indirect de la justesse des remarques de M. Rousseau, qui joint à beaucoup de connaissances & de goût en Musique le talent de penser et de s'exprimer avec netteté, que les Musiciens n'ont pas toujours, est trop en état de se défendre par lui-même, pour que nous entreprenions ici de soutenir sa cause. Il pourra, dans le Dictionnaire de Musique qu'il prépare, repousser les traits qu'on lui a lancés, s'il juge, ce que nous n'osons assurer, que la brochure de l'Anonyme le mérite. Pour nous, sans prendre d'ailleurs aucune part à une dispute qui nous détournerait de notre objet, nous ne pouvons nous persuader que l'Artiste célèbre à qui l'on attribue cette production en soit réellement l'Auteur. Tout nous empêche de le croire : le peu de sensation que la critique nous paraît avoir fait dans le Public. Des imputations aussi déplacées que déraisonnables dont cet Artiste est incapable de charger deux hommes de Lettres qui lui ont rendu en toute occasion une justice distinguée, & qu'il n'a pas dédaigné de consulter quelquefois sur ses propres Ouvrages : la manière peu mesurée dont on traite dans cette brochure M. Rousseau, qui a souvent nommé avec éloges le Musicien dont nous parlons (2), et qui ne lui a pas manqué d'égards, même dans le petit nombre d'endroits où il a cru pouvoir le combattre : enfin, les opinions plus que singulières qu'on soutient dans cet écrit, & qui ne préviennent pas en sa faveur, entre autres, que la Géométrie est fondée sur la Musique ; qu'on doit comparer à la Musique quelque science que ce soit ; qu'un clavecin oculaire dans lequel on se bornerait à représenter l'analogie de l'Harmonie avec les couleurs, mériterait l'approbation générale, & ainsi du reste.(3) Si ce sont là les vérités qu'on nous accuse d'ignorer, de négliger ou de dissimuler, c'est un reproche que nous aurons le malheur de mériter longtemps. On lit encore dans le 2e Alinéa ligne 9 : ce serait nous rendre les tyrans de nos Collègues, & nous exposer à en être abandonnés avec raison, que de vouloir les plier malgré eux à notre façon de penser ou à celle des autres. REPONSE. (4) Je me vois à regret forcé, Messieurs, de quitter un Code de Musique pratique déjà fort avancé ; mais je ne puis me dispenser de me justifier auprès du Public. Vous m'accusez, vous m'attaquez, Messieurs, encore si vos citations étaient fidèles ; mais vous les altérez, soit en les détachant de ce qui précède & de ce qui suit, soit en étendant les conséquences de ce que je dis, soit en donnant à mes propositions un sens qu'elles n'ont point. J'avais dans ma brochure relevé quelques erreurs sur la Musique dans lesquelles M. Rousseau était tombé. Il me semble qu'au lieu d'écrire contre moi, vous auriez dû écrire pour lui. Vous me renvoyez à un dictionnaire qu'il compose, mais quand viendra-t-il ? En vérité, Messieurs, il aurait mieux valu répondre à la difficulté qu'à la personne. Je ne reconnais point dans votre Avertissement, du moins en ce qui me regarde, ces deus hommes supérieurs encore aux éloges qu'ils se donnent mutuellement. Je n'y vois point cet amour de la vérité qui pourtant, dans un Ouvrage comme celui que vous avez entrepris, devrait marcher le premier. Il me semble y reconnaître plutôt un Ecrivain enivré de ses idées, qui oublie ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a lu, ce qu'il a écrit lui-même, & qui s'imagine qu'on le croira sur sa parole ; qu'on ne confrontera rien, & que tout ce qu'on y pourra répondre, ne fera pas la moindre sensation dans le Public.(5) Vous débutez par la fin de la brochure, dont vous retranchez la première phrase, & vous m'y faites prononcer en Maître : Je crois devoir mettre les Editeurs de l'Encyclopédie sur la voie des Vérités, &c. lorsqu'on y lit, 124. Je ne me suis étendu dans des digressions sur un Art dont on peut encore tirer quelques lumières que pour mettre les Editeurs du Dictionnaire Encyclopédique sur la voir des vérités qu'ils ignorent, négligent ou dissimulent, &c. Ces digressions ne qu'accessoires ; mais en les changeant d'ordre, en les isolant, tronquant et simplifiant, vous leur donnez une tournure qui, de simples proportions, en fait des Lois. Elles n'ont même aucun rapport direct avec les erreurs que je condamne. Ce ne sont que comme autant de véhicules pour exposer les principes sur lesquels porte la condamnation. J'y propose en temps certaines conjectures, dont on pourrait tire, ce me semble, des conséquences favorables à d'autres Art, à d'autres Sciences. Les vérités que je vous accuse d'ignorer, de négliger ou de dissimuler, sont des vérités par lesquelles je relève les erreurs, & c'est à l'Auteur de ces erreurs que je m'adresse, non à vous, Messieurs, que j'ai tout lieu de considérer. (6) Quant aux digressions dont je me sers pour mettre l'Auteur sur la voie de ces vérités, je n'attaque personne en particulier ; j'y témoigne seulement désirer que les Géomètres & les Physiciens en général voulussent bien éclaircir les doutes, & juger de mes propositions sur les principes posés dans le petit extrait que j'en donne à la fin de cet Ouvrage. Je sens bien que vous ne pouvez ignorer des vérités que j'ai produites au jour ; mais souvent la critique se passionne & s'aveugle, on ne pèse point assez ce qu'on écrit, quelquefois même on va plus loin, on dissimule, comme le prouve la note précédente. Mais n'y a-t-il, Messieurs, que de la dissimulation, quand vous me faites prononcer en Législateur : Je crois devoir mettre les Editeurs sur la voie &c. sans dire quelle est cette voir dont je me sers pour autoriser les vérités qui résument des erreurs : loin de là, vous isolez mes conjectures, auxquelles vous donnez un air de sentence, pour les mettre au nombre des vérités qu'on vous accuse d'ignorer &c. si l'on doit vous croire ; vous les tronquez, amplifiez, voue en changez même l'ordre, pour cacher apparemment les rapports qu'elles ont entre elles. Vous me faite dire alors que la Géométrie est fondée sur la Musique ; qu'on doit comparer à l'Harmonie quelque Science que ce soit 64 ; qu'un clavecin oculaire dans lequel on se bornerait à représenter l'analogie de l'harmonie avec les couleurs mériterait l'approbation générale 46 ; et ainsi du reste. Ne croirait-on pas à vous entendre, Messieurs, que j'affirme tout cela bien positivement ? tandis que de tels passages ne se rencontrent dans mon écrit que comme des conjectures relatives à ce qui précède. Votre ainsi du reste ne signifie-t-il pas que tout est dans la brochure aussi positif que ce que vous citez ? Je l'accorde, c'est me donner gain de cause. Que veut dire, par exemple, ce Clavecin oculaire que vous m'attribuez ? C'est votre ouvrage, je vous l'abandonne. Voici ce que je revendique comme de moi. Au milieu d'une discussion pour prouver que la mélodie & les effets (7) naissent de l'harmonie, je dis, 46, Si le R. P. Castel s'en est tenu à l'harmonie pour constater son analogie avec les couleurs, je crois qu'il aurait eu autant de partisans que de lecteurs. Remarquez bien mon doute par ces mots, je crois ; remarquez en même temps la différence des deux phrases sur le même sujet : il en est de même des autres. Est-il là question de Clavecin oculaire ? pourquoi me faire affirmer, lorsque je dis simplement, je crois ? Ma réflexion, comme vous l'avez dû voir, n'a lieu qu'autant que l'Auteur a confondu la Mélodie avec l'harmonie : aussi n'est-ce qu'un conséquence de cette réflexion précédée & suivie de quelques autres sur le même sujet, que je dis, 64. Ainsi toute la Musique étant comprise dans l'harmonie, on en doit conclure que ce n'est qu'à cette seule harmonie qu'on doit comparer quelque Science que ce soit : c'est-à-dire, que si l'on veut comparer une Science à la Musique (comme on l'a déjà fait plus d'une fois, en prenant la Mélodie seule pour l'objet) ce n'est qu'à l'harmonie qu'il la faudrait comparer. Ce mot Ainsi, par où débute ma dernière conclusion, veut dire simplement, il suit de là : pourquoi donc l'avez-vous omis dans votre citation, comme aussi le mot seule joint à harmonie ? Sans parler de l'extrême différence entre cette citation & l'original. Une pareille conduite est-elle excusable ? Si ce mot, Ainsi, se rapporte à ce qui précède, trouve-t-on dans ce qui précède la moindre idée de comparaison entre la Musique & d'autres Sciences ? J'ai simplement saisi, conséquemment à la question agitée, une comparaison déjà faite, où la Mélodie se trouve confondue avec l'harmonie, pour en dire mon sentiment, sans décider. Comment peut-on en renvoyer aux originaux avec de telles infidélités ? Je n'ai point dit, Que la Géométrie est fondée sur la Musique, cela ne se trouve en aucun endroit de l'Ouvrage. Vous concluez de mes propositions ce qu'il vous plait, sans vous embarrassez du sens qu'elles portent. Nous ne pouvons nous persuadez, dites-vous, que l'Artiste célèbre à qui on attribue cette production (ces sont les erreurs sur la Musique) en soit réellement l'Auteur : (8) si cela est, pourquoi reprocher à cet Artiste les obligations qu'il vous a, les éloges & les égards de M. Rousseau pour lui ? Il me semble que vous deviez simplement répondre à l'Anonyme que vous supposez, & comme je l'ai déjà dit, répondre à la difficulté plutôt qu'à la personne. Si vous m'avez rendu justice, un Partisan de plus ou de moins n'établit point les réputations. Vous dites que je n'ai pas dédaigné de vous consulter ; vous deviez dire au contraire que vous m'avez fait l'honneur de venir prendre de mes leçons, pendant quelques mois, sur la Musique théorique et pratique, & que par conséquent c'est vous qui m'avez consulté : quand vous m'avez proposé des doutes, qui de nous les a éclaircis ? Que prouvent, en ce cas, vos Eléments de Musique théorique & pratique, que vous intitulez, vous même, selon les principes de M. Rameau ? Vos éloges, vos égards ne paraissent pas plus sincères que ceux de votre Collègue. Ne voit-on pas bien qu'en m'honorant des titres d'Artiste célèbre & de Musicien, vous voulez me ravir celui qui n'est dû qu'à moi seul dans mon Art, puisque j'en ai formé le premier une Science démontrée, après en avoir découvert le principe dans la Nature. Quel éloge peut égaler la justice que vous & votre Collègue auriez pu me rendre dans les conjonctures présentes ? Vous soutenez mal aujourd'hui ce que, de concert avec l'Académie des Sciences, vous avez signé vous-même. (9) C'est dans les faits, non dans les paroles que se reconnaissent les vrais éloges, les vrais égards. Que signifie, par exemple, cette Lettre sur la Musique Française ? Etait-ce à la Musique Française qu'on en voulait, ou au Musicien Français ? (10) Qu'on examine d'ailleurs, dans l'Encyclopédie, l'article sur la Dissonance, on verra des preuves de ces prétendus égards. Pour corriger l'erreur de quelqu'un, il faut bien la lui montrer. Le peut-on mieux, en effet, qu'en l'avertissant qu'il s'accuse lui-même d'un défaut de jugement & d'oreille en Musique, lorsqu'il prétend tendre les accords par supposition susceptibles de renversement, 72 ? Hé bien ! quand on le prouve à M. Rousseau, vous dites qu'on lui lance des traits. Que ne m'en lancez-vous de pareils ? Il n'y a rien d'offensant pour ceux qui veulent s'instruire, que le défaut de vérité. En laissant, comme vous le dites, à votre Collègue le soin de se défendre, s'il juge, ce que nous n'osons assurer, (ces sont vos termes) que la brochure le mérite, est-ce bien la vérité qui vous suggère ces mots, ce que nous n'osons assurer ? Sont-ce là mes Ecoliers qui parlent ? Est-ce l'Auteur des Eléments de Musique, &c. selon les principes de M. Rameau ? Après de tels procédés, Messieurs, n'ai-je pas raison de douter que ce qui me regarde dans votre Avertissement fait de votre main, doute d'autant plus sincère qu'il est fondé sur l'estime que je ne puis encore vous refuser : au lieu que le vôtre sur l'Anonyme (que vous supposez) n'a d'autres prétextes que de pouvoir lui imputer gratuitement des opinions plus que singulières ? N'auriez-vous pas mieux fait d'avouer les fautes, de les corriger, & de profiter de l'avenir des principes qui les condamnent, que de prendre, en voulant vous justifier, des voies indirectes, & mêmes infidèles ? Je ne crois pas qu'elles préviennent beaucoup en votre faveur : les opinions plus que singulières, selon vous, qu'on soutient dans ces écrits, sont votre ouvrage & non le mien, par la singularité dont vous avez su les revêtir. N'en parlons plus, & finissons en vérifiant votre ainsi du reste, qui ne peut plus rouler que sur la fin de la brochure où vous renvoyez, & où l'on ne trouvera qu'expositions de principes, réflexions, propositions, questions, & doutes de ma part, loin d'y avoir pris ce tons de Maître que vous me prêtez : aussi n'ai-je envisagé cette fin que comme des digressions propres à mettre sur la voie des vérités &c. En voici le précis, avec quelques nouvelles réflexions encore : vous avez si mal combattu les premières, que loin de m'avoir rebuté, vous m'avez enhardi : si je me trompe, lancez-moi pour lors des traits vraiment dignes de vous ; il n'y a d'offensant pour ceux qui veulent s'instruire, je le répète, que le défaut de vérité. Le savant a de grands droits sur l'ignorant : mais l'homme qui pense a les siens particuliers : tels sont vos sentiments en faveur de M. Rousseau dans votre Avertissement. S'il est vrai que la Géométrie soit fondée sur les proportions, & si le Corps sonore les fait entendre, voir, & sentir même au tact dans le moment qu'il résonne ; il est tout naturel d'en conclure que les Sciences (11) doivent avoir une liaison intime avec la Musique. 110. 113. 114. 116. Je ne vois que cette dernière conclusion d'où vous ayez pu inférer que la Géométrie est fondée sur la Musique, Mais sur qui retombe pour lors la singularité de l'opinion, dès que l'opinion vient de vous ? Je crois cependant qu'il serait beaucoup plus facile d'en prouver la possibilité que la singularité. En effet, si l'on doit regarder le corps sonore comme la racine des proportions, 113, 114. ce qui tient à l'arbre doit nécessairement tenir à sa racine. Ou vous devez en convenir, ou vous dédire de l'approbation que vous avez donnée à ma Démonstration du Principe de l'Harmonie. Allons plus loin dans l'examen du fait. On peut dire d'abord que le Phénomène du corps sonore est la première merveille que la Nature ait encore soumise à notre raison. Croire, en effet, n'entendre qu'un son où l'on en distingue trois différents, & le prendre toujours pour unique, quoiqu'on le sache triple (12), à qui pourrait-on persuader cette vérité, si on ne la lui faisait toucher au doigt & à l'oeil : je dis fort bien, au doigt & à l'oeil ; car l'oeil voit pour lors frémir les cordes accordées au ton des sons que fait résonner le corps sonore ave celui de sa totalité, il le voit se diviser, & compte les partie, pendant qu'en les effleurant avec l'ongle, le doigt en distingue les noeuds d'avec les ventres de vibrations. Mais comme c'est à présent un fait connu, on se familiarise avec cet espèce de miracle. Voyons tout. La manière dont les proportions se produisent, confirme cette merveille. D'abord la proportion géométrique se fait reconnaître dans 1/2 1/4 du corps sonore 1, & l'harmonique dans [1/3 1/5*] de ce même corps sonore ; mais comme celle-ci résonne, pendant que l'autre est muette, pour ainsi dire, on ne s'est encore attaché qu'à l'harmonique ; ce qui mérite bien d'être approfondi. A laquelle de ces deux proportions donner la préférence ? L'une est muette, l'autre se fait entendre, lorsque cependant les parties de celle-ci, 1/3 1/5, sont plus petites que celles de la première, 1/2 1/4, dont le plus d'élasticité devrait par conséquent se prêter plus facilement aux impulsions de l'air, qui en renvoie le son à l'oreille. Voilà du neuf ? te jusqu'à présent j'avais oublié d'en faire mention. C'est sans doute pour nous faire sentir la supériorité des rapports doubles ou sous-doubles, 1. 1/2 1/4 &c. que la Nature a fait naître pour l'oreille une espèce d'identité dans les octaves qui en sont formés (13), de manière qu'elles se confondent dans leur principe & ne s'en distingue point : au lieu qu'elle a permis qu'on distinguât les moins parfaits, 1. 1/3 1/5 ; mais seulement lorsque le corps sonore résonne seul, & qu'on y donne la plus grande attention. Remarquons ici comment la Nature se développe, & combien la raison doit en être satisfaite : se trouve-t-il aucun objet palpable à nos autres sens, qu'on puisse comparer à ce que nous venons de reconnaître ? Ce n'est pas tout ; cette même proportion géométrique se reproduit dans les multiples (14), 1. 2. 4 pendant pendant que l'harmonique s'y change en Arithmétique, 1. 3. 5. l'une est stable, & ne varie point, parce qu'elle doit toujours servir de racine, de base aux autres : stabilité désignée par la même identité de chaque côté, 1. 1/2 1/4 ; l'autre varie pour donner effectivement la variété que doit fournir l'arbre dans ses branches, variété qui se multiplie par l'identité des Octaves, représentant toujours leur principe, soit à l'aigu, soit au grave. Dans les Multiples les proportions dégénèrent beaucoup ; car ce n'est que sur les différentes grandeurs des corps comparés entre eux qu'elles peuvent se reconnaître, le principe, par résonance, ramenant à lui tout les corps plus grands que le sien, en les forçant de se diviser dans ses unissons : cependant le Géomètre a toujours préféré la proportion Arithmétique à l'harmonique, quelle en est la raison ? 117. 118. Son bonheur, dans ses recherches est, sans doute, d'avoir trouvé partout la même proportion géométrique. S'agit-il de donner une succession à l'harmonie ; son principe, son générateur, sa racine, sa base, que j'appelle en conséquence Basse fondamentale, forme encore de nouvelles proportions géométriques, en associant à sa marche les termes qui lui répondent, de part & d'autre, en mêmes rapports, & promenant toujours avec chacun de ses termes, qui sont autant de corps sonores, l'une des deux autres proportions. On ne doit rien attendre de nouveau de la proportion 1.1/, 1. 2. (15), puisque ce ne sont que des Octaves qui se confondent dans leur principe ; mais avec celle-ci 1.1/3, 1. 3. ce principe établit des Modes, & avec cet autre, 1. 1/5, 1. 5. il fournit les moyens d'entrelacer ces Modes, & de donner à la musique toute la variété dont elle est susceptible : laissant à part la dissonance, dont le goût a fait sentir que ces proportions pouvaient se surcharger, comme d'un ornement propre à mettre comble à cette variété. (16) Quel ordre, quelle simplicité, quelle fécondité, quelle précision ! On suppose au corps sonore le même droit sur la proportion Arithmétique que sur l'Harmonique, attendu que leurs Accords sont également agréables, dès qu'ils sont analogues aux sentiments qu'on veut exprimer : aussi les appelle-t-on également Accords parfaits. Tel est le pouvoir prédominant de la proportion géométrique dans la Musique, tel il est, dit-on, dans l'Architecture, & tel il doit être, si je ne me trompe, dans bien d'autres Sciences : je crois du moins mon soupçon fondé. On sait bien que chaque Art, chaque Science a ses propriétés particulières ; 117. mais ne pourraient-elles pas dépendre toutes d'un même principe ? Y a-t-il plus d'un principe dans la Nature ? En pouvons-nous découvrir par un autre canal que par celui de nos sens ? Et peuvent-ils nous en offrir un qui leur soit aussi palpable que la résonance du corps sonore, & d'où la certitude des rapports puisse naître, comme elle naît ici, de l'effet qu'éprouve l'oreille ? Lorsqu'on dit que nos sens sont trompeurs, ce n'est certainement pas de l'oreille dont on veut parler, puisqu'on dit en même temps, superbissimum auris judicium. En effet l'oreille commande au compas, pendant que le compas commande à l'oeil. Jusqu'à ce que les jambes du compas soient directement sur les sections des cordes qui doivent faire entendre telle ou telle consonance, l'oreille n'est point satisfaite : au lieu que l'oeil ne peut juger d'aucun rapport sans le secours du compas, encore peut-on s'y tromper. Pourquoi donc l'oeil est-il appelé dans la Musique (laissant le tact part) lorsque les connaissances qu'on en peut tirer sont absolument inutiles, & pour la jouissance de l'Art, & pour la procurer ? On sait assez que toute préoccupation de l'esprit distrait des fonctions naturelles : parc conséquent si l'on pense que tels rapports sont entre eux comme 2. 3. par exemple, & cela dans le moment qu'on en veut éprouver l'effet : en satisfaisant l'esprit, l'oreille perd tous ses droits. 123. Il en est de même du Compositeur : s'il pense seulement au degrés des intervalles qu'il veut employer, si la tierce, la quinte &c. ne se présentent pas à son imagination, avant qu'il sache ce que c'est, n'attendez rien de lui qui puisse vous plaire. Telle est la Musique du Géomètre que ne se guide que par le calcul : aussi le Musicien n'a-t-il jamais voulu l'écouter. 121. 122. Ce fait est constant, toute préoccupation de l'esprit nuit également au Compositeur, & à l'Auditeur, 123. : ce qui doit autoriser, ce me semble, la conséquence que je vais en tirer. Mettons de côté les erreurs dans lesquelles le Mathématicien a donné. Examinons seulement quel a pu être son but, lorsque de concert avec les plus grands Philosophes de tous les temps, il s'est obstiné dans le projet d'approfondir un Art pour lequel il a inutilement épuisé ses calculs. Sans doute que reconnaissant qu'il fallait à l'esprit une certitude sur les rapports qu'ont entre eux les différents objets qui frappent nos sens, 113. & convaincu, selon cette maxime, superbissimum &c. que ce droit n'appartient qu'à l'oreille dans la Musique, il a fait tous ses efforts pour en tirer un grand avantage ; mais après de vaines recherches, il a tout abandonné à peu près dans le temps où le principe qu'il cherchait s'est offert à ses yeux comme à son oreille. Ce principe est le Phénomène du corps sonore, Phénomène reconnu depuis un siècle, & dont on n'a fait que s'amuser comme d'un simple objet de curiosité, jusqu'à ce qu'enfin je l'aie fait reconnaître pour le Principe de l'Harmonie, c'est-à-dire de la Musique ; mais n'a-t-il de droits que sur cette seule Science ? Pourquoi l'oeil, encore une fois, y serait-il appelé, lorsqu'il y est inutile ? Serait-ce en pure perte, sans nécessité, que l'oeil emprunterait ici le secours de l'oreille, lorsqu'elle n'a nul besoin du sien ? Cependant la Nature ne s'explique point en vain, 112. L'on a quelquefois représenté au Géomètre que notre raison était trop bornée pour pouvoir pénétrer jusque dans les secrets de la Nature. En voici un, que faut-il de plus à la raison, lorsque tout autre principe lui est interdit par la voie des autres sens ? Croit-on n'en avoir plus besoin ? Que sait-on, tout n'est pas découvert. Je ne dois mes découvertes en Musique qu'aux lois de la Nature, dont le corps sonore nous présente un modèle (17), & dont l'observation est en même temps si simple & si lumineuse qu'aujourd'hui le Musicien, d'accord avec le Géomètre, m'écoute, m'entend & m'imite. Que ne peut-on les suivre de même, ces Lois, dans toutes les autres Sciences ? Quel fruit n'en pourrait-on pas tirer, ne fût-ce que pour en faciliter l'intelligence ? Outre les opérations du Géomètre diamétralement opposées à ces Lois, il confond encore, du moins dans ses Eléments, le rapport original de la proportion Arithmétique, & de l'Harmonique avec ses renversements, & ses imitations même, 117. 118. 119. 120. j'en ignore les conséquences, mais la différence en est grande en Musique, selon l'exemple que j'en donne, 121. où le Physique tient au Géométrique, c'est-à-dire, où l'effet tire toute sa force de l'exacte imitation de la Nature dans la proportion harmonique. Voilà, Messieurs, en quoi consistent, à peu près, les digressions qui conduisent aux vérités dont je me suis servi pour condamner les erreurs sur la Musique répandues dans votre Dictionnaire : vous auriez pu les éviter en me communiquant vos Manuscrits que je vous avais offert d'examiner, après m'être excusé de pouvoir entreprendre tout l'Ouvrage ; mais votre Avertissement fait assez sentir la raison qui vous en a détourné : il vaut mieux ménager les Collègues que le Public. J'ai l'honneur d'être, Messieurs, votre &c.
(1) Voyez la brochure qui a pour titre : Erreurs sur la Musique dans l'Encyclopédie. (retour au texte) (2) Voyez les notes Accompagnement, p. 75 col. 2 vers la fin ; Basse, p. 119, col. 2, & surtout à la fin du mot chiffrer. (retour au texte) (3) Voyez la brochure citée, p. 46, 64, & surtout depuis la page 110 jusqu'à la fin. (retour au texte) (4) Les chiffres dans le discours indiquent les pages des Erreurs sur la Musique où je renvoie pour lors. (retour au texte) (5) On dit dans l'Avertissement, le peu de sensation que la critique paraît avoir fait dans le Public. Le dégoût causé par l'extrême simplification de choses inutiles, dans des Articles où l'on ne cherche qu'à s'instruire, aura bien pu rejaillir sur une critique déjà faite. Il n'y a, d'ailleurs, de vrais Curieux dans les Arts que les Artistes & les Amateurs. Je me demande si les articles de géométrie on dû faire une grande sensation dans le Public. (retour au texte) (6) Ces Messieurs affectent d'ignorer la suite des erreurs, &c. donnée en Mars 1756, où la méprise sur laquelle ils se prétendent compris dans ces erreurs leur est si bien spécifiée, même avec protestations d'estime & d'amitié de ma part, qu'ils ne pouvaient plus y répondre qu'au nom de M. Rousseau : mais leurs reproches, quoiqu'injustes, & les moyens peu usités qu'ils emploient pour parvenir à leur fin, avaient besoin d'une petite dissimulation. (retour au texte) (7) Il ne faut point confondre l'effet de l'exécution avec celui de la mélodie en particulier. (retour au texte) (8) J'ai envoyé dans le temps à ces Messieurs (l'un ou l'autre, c'est tout un) le premier exemplaire de cette production, avec un mot d'écrit signé de ma main : ainsi leur doute sur ce sujet n'est nullement recevable : on voit qu'il part du même esprit que leurs citations. (retour au texte) (9) Extrait de la démonstration du Principe de l'Harmonie. (retour au texte) (10) Les Partisans de M. Rousseau allaient pour lors annoncer de maison en maison qu'il paraîtrait bientôt un Ouvrage qui devait extrêmement humilier Rameau. On a toujours cru Messieurs les Editeurs dans le secret, attendu le peu de part qu'ils y ont pris, lorsque cependant il s'y trouve contradiction avec un des Articles de l'Encyclopédie, & lorsque l'un d'eux avait ses Eléments de Musique à défendre. Pour moi, j'affectai d'ignorer une critique qui devait tomber d'elle-même, & me contentai de rétablir la réputation de celui à qui nous devons le bon goût de notre Musique, & qu'on n'avait feint d'attaquer, que pour mieux cacher son jeu. (retour au texte) (11) On ne doit entendre que les Sciences soumises au Calcul. (retour au texte) (12) V. les Expériences de la Génération Harmonique, surtout aux p. 13 & 14. (retour au texte) (*) sous toutes réserves car les valeurs étaient difficiles à lire sur la brochure originale. (retour au texte) (13) Réponse sur l'identité des Octaves. (retour au texte) (14) On appelle Parties aliquantes, ou Multiples, les corps plus grands que celui auquel on les compare, & parties aliquotes, ou Sous-multiples les divisions d'un corps quelconque. (retour au texte) (15) Retranchez la première unité de chaque proportion, vous aurez, dans les nombres donnés, les proportions, doubles, triples, & quintuples, dont les dénominateurs sont les seules consonances qu'il y ait en Musique, & qui naissent de leur racine, ou corps sonore, bien entendu que ce qui en est renversé les représente. 115. (retour au texte) (16) Démonstration du Principe de l'Harmonie. (retour au texte) (17)
C'est un Tout divisible en une infinités de parties, qui
se fait reconnaître en un même temps pour le seul et unique
Tout, en forçant les corps plus grands que le sien à se
diviser en ses Unissons : joignons à cela ces deux
proportions, la Géométrique & l'Harmonique, dont les
propriétés que je viens de déduire, méritent assez qu'on
y réfléchisse ; puisque de la seule résonance de ce
Tout résultent dans le même instant, Racine, Arbre, Branches,
Proportions, Progressions, Division, Addition, Multiplication,
Quarrés, Cubes, &c. Que de principes dans un seul !
La Nature s'y serait-elle épuisée pour le seul plaisir de
l'oreille ? On ne saurait trop répéter des faits d'expérience,
dont j'espère que cette courte récapitulation fera peut-être
plus d'impression qu'elle ne paraît en avoir fait encore
jusqu'à présent. (retour au texte) |
