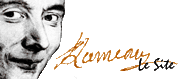
"to
hide art by very art"
"cacher l'art par l'art même"
|
Réflexions
sur la manière de former la voix et d'apprendre la musique |
|
Réflexions
de Monsieur Rameau sur la manière de former la voix et d’apprendre
la musique, et sur nos facultés en général pour tous les arts
d’exercice.
Publié dans le Mercure de France, octobre, 1752, pp.87-100.
Dans tous les exercices qui ont rapport à la Musique, soit le Chant, soit les Instruments, soit la Danse, le sentiment de la mesure et de l’harmonie est également naturel à tous ; celui de la mesure nous est même commun avec les bêtes, puisque leurs mouvements sont toujours égaux, c’est-à-dire en mesure. Ce qui empêche le plus souvent de mettre ces talens à profit aussitôt qu’on pourroit, et ce qui nous en distrait même quelquefois au point d’imaginer que la nature les a refusés, c’est une trop grande préoccupation qui tient dans la gêne, qui fait qu’on se presse, qu’on s’efforce, et qui ôte par là tout le moyen d’agir librement. Qu’un Commençant ne se prête pas d’abord aux mouvemens qu’on lui prescrira, cela se peut ; mais qu’on lui laisse prendre de lui-même un mouvement, il le suivra en mesure dès que rien ne le préoccupera d’ailleurs. L’oreille ne lui manque donc pas de ce côté ; et c’est au Maître à sçavoir le conduire pour lors à proportion de ses dispositions. Ne voit-on pas souvent des personnes exécuter parfaitement de la musique en mesure, et ne pouvoir danser de même ? Dira-t-on que c’est dans ce dernier cas un défaut d’oreille, lorsqu’elles donnent ailleurs de si fortes preuves du contraire ? Qu’on ne s’y trompe donc plus, et reconnoissons que c’est sans doute la préoccupation où les tient une partie des objets nécessaires à l’exécution qui les distrait de leurs fonctions les plus naturelles. Dans la Danse il s’agit d’un certain mouvement des pieds, des jambes, des bras, des poignets, même de la tête ; et d’une certaine grace dont il n’est nullement question dans la Musique ; de sorte qu’il n’est pas étonnant que celui qui agit avec moins de liberté d’un côté que de l’autre, n’y fasse pas valoir également des talens. Le sentiment de l’harmonie ne se développe pas si promptement en nous que celui de la mesure ; il demande de l’expérience, et il faut, avant que l’oreille puisse s’y former, entendre souvent de la musique. Ceux qui entendent de la musique dès l’enfance, et qui l’entendent continuellement, y sont généralement les plus sensibles. Le tems où l’esprit n’est ordinairement occupé que du présent, est celui où les impressions se gravent le plus fortement ; et si avec cela on s’y prête avec plaisir, la sensibilité ne devient que plus forte et plus prompte. Il y a telles situations, telles occupations qui ne nous permettent pas de nous livrer à la musique ; et quand même nous en entendons, notre esprit trop plein de ses idées nous empêche de pouvoir nous y prêter : qu’on ne soit donc pas surpris si pour lors les apparences ne sont pas en notre faveur. Il y a plus de vingt cinq ans qu’il me tomba entre les mains un jeune homme qui ne pouvait prendre l’unisson, ni l’octave d’aucun son, qui paraissoit même avoir la voix fort discordante, et qui pour cette raison avait été désespéré de tous les Musiciens qui l’avoient éprouvé : je lui fis donner un son à sa fantaisie, je luis dis ensuite de crier plus fort et plus vite, sans y penser, car il ne sçavait pas ce que veut dire plus haut ou plus bas, il donna sur le champ la Quinte de ce premier son : d’où je conclu qu’il était né Musicien comme un autre, et qu’il le deviendrait avec le tems, en le sçachant conduire : aussi parvint-il dans l’espace de deux ou trois mois à pouvoir entonner juste et successivement toute sorte d’intervalle, à la faveur d’une méthode que j’imaginai pour lui. Le R.P. Castel à qui pour lors j’en fis part, en a touché quelque chose dans un Journal de Trévoux. Ce jeune homme, sans doute, toujours occupé de quelques idées, n’avoit jamais prêté son attention non-seulement à la Musique qu’on lui faisoit entendre quelquefois, mais pas même au chant des Eglises qu’il entendoit souvent, non plus qu’à celui des rues, ni qu’au son des cloches qu’il pouvoit entendre chaque jour. Ce qui fait que presque tous les commençans en musique entonnent aisément les moindres degrés naturels à la voix, come ut, ré, mi, fa, etc. c’est qu’ils s’y sont familiarisés à force de les entendre ; mais s’il s’en trouve qui les entendent sans les écouter, ces degrés leur sont aussi étrangers que toutes les choses dont ils n’auraient jamais eu aucune notion : c’est don au Maître à chercher la cause de cette surdité apparente. D’un autre côté, j’ai vu des personnes de 40 à 50 ans insensibles à l’harmonie, et y devenir sensibles au point d’en juger sainement, même sur le goût, à la faveur des leçons de musique qu’on donnoit à leurs enfans auxquelles elles assistaient chaque jour. Ce qui me fit remarquer pour la première fois que l’harmonie nous étoit naturelle, ce fut un homme âgé de plus de 70 ans, qui, dans le Parterre de l’Opéra de Lyon, se mit à chanter tout haut, et assez fort, la basse fondamentale d’un chant dont les paroles l’avaient frappé ; j’en fus d’autant plus surpris que par la rumeur que cela fit dans le Spectacle, j’appris que c’étoit un Artisan d’une profession dure et grossière, que sa condition et ses occupations avoient long tems éloigné des occasions d’entendre de la Musique et qui ne fréquentoit l’Opéra que depuis que la fortune l’avoit un peu favorisé. Quoi ! me dis-je alors, un tel homme est capable d’entendre une basse fondamentale qui ne se trouve exprimée ni dans le Chant ni dans l’accompagnement, cela prouve bien que l’harmonie nous est naturelle. Mes réflexions allèrent plus loin, elles me firent imaginer une règle pour faire trouver à quiconque à la voix un peu juste, la Basse fondamentale de tous les repos d’un chant. Voyez sur ce sujet le Chap. 10 de mon nouveau système, p.54. La flexibilité des mouvemens propres à l’éxécution de tous les exercices, est encore une de nos facultés pour la Musique. Quelques-uns s’en croyent privés jusqu’à s’opposer même un vice de conformation dans les organes. Mais c’est une exception à la loi générale, sur laquelle on ne peut raisonnablement se fonder : et d’ailleurs outre que ce vice est très rare, c’est d’une ressource d’excuse ordinaire à tous ceux qui se sont mal conduits dans leurs exercices. Cette faculté nous est tout aussi naturelle que celle de marcher, de courir : et ce qui nous empêche de réussir aussi bien à l’une qu’à l’autre, c’est que nous n’y observons pas la même régularité dans notre conduite. Pourquoi marchons-nous ? pourquoi courons-nous presqu’également ? car les moins concernés courent dans un besoin pressant, et cela suffit pour la preuve : c’est que dès l’enfance nous nous en sommes accoutumés à porter un pied devant l’autre sans nous presser, sans nous contraindre, sans nous forcer ; nos mouvemens se sont formés insensiblement, ils ont gagné de la vitesse à mesure que nos forces se sont augmentées et nous sommes parvenus enfin à cette agilita presqu’égale dans la course. Il est vrai que tous ne courent d’une égale vitesse, et qu’on ne peut en attribuer la cause à des dispositions plus ou moins heureuses ; mais sans nous arrêter à la différence des tempéramens et des conformations, qui est une des causes principales, nous voyons du moins que le reste n’est que l’affaire du tems. Si l’on pouvait se livrer à tous les exercices dès la plus tendre enfance, les dispositions s’y trouveraient proportionnées en nous à peu près comme dans la course ; il n’y a pas de mouvemens dont nous ne soyons capable dès qu’on s’y prend d’assez bonne heure, pour nous y accoutumer : les danseurs de corde en fournissent une assez grande preuve dans leurs enfans ; mais avant que de nous livrer à ces exercices, nous prenons sans y penser des habitudes contraires à celles qui leur conviennent ; c’est en cela justement que consistent les mauvaises dispositions qu’on remarque pour lors en nous, et qu’on attribue presque toujours à la nature. Plus ces habitude sont invétérées, plus il est difficile de les détruire, sans que cela soit cependant impossible, parce qu’il s’agit pour lors que de se remettre dans la voye simple et naturelle, dont on s’était écarté ; mais nos maîtres généralement moins versés dans ces secrets de la nature que dans ceux de l’art, ne s’attachent point assez aux causes : uniquement occupés des effets, ils ne jugent de notre capacité dans l’exécution que par ces effets, et n’attendent par conséquent toujours trop tard pour avertir d’un vice qu’il n’y a presque plus moyen de corriger, sans recommencer de nouveau. Cela rebute : on aime mieux rester avec ses défauts, les imputer même à la nature, et c’est ordinairement ainsi que l’écolier se console, et que le maître se disculpe. Pour faciliter la production d’un effet, on en doit connoître la cause, sans cela se seroit tout au plus par hazard qu’on pourroit y parvenir. Ce hazard prend sa source dans d’heureuses habitudes qu’on nomme dispositions. Ces habitudes consistent à conserver dans les mouvemens la souplesse naturelle, on ne perd cette souplesse qu’à l’occasion de certaines préoccupations qui portent à se presser, à se gêner, à se forcer. Ces préoccupations naissent généralement des différents objets qui concourent à l’exécution, et qui se présentent en foule avant qu’on puisse les démêler : le trop de vivacité, le trop d’empressement, la connoissance du but font qu’on veut trop tôt y atteindre ; le maître même y contribue le plus souvent, faute se sçavoir ralentir à propos l’ardeur d’un commençant. On est surpris après cela d’avoir longtemps pratiqué sans succès, on ne sçait à quoi s’en prendre, et c’est pour lors que la nature n’est point épargnée. Le défaut de souplesse est occasionné par une infinité d’accidens simplement sensibles, ou sensibles et visibles en même tems ; par exemple, celui qui chevrotte une cadence en chantant, doit sentir qu’il force le vent, et qu’il serre le fond de la bouche, je veux dire la glotte : on le sent et on le voit de plus dans la main et dans les doigts, lorsqu’on bat de même cette cadence sur un instrument ; mais bien plus, une grimace, une contrainte dans quelque partie du corps que ce soit, une main trop serrée, des doigts trop pressés, trop écartés, trop allongés, trop courbés, le corps déplacé, un mouvement involontaire ; enfin mille moyens s’offrent pour faire sentir et apercevoir qu’on n’est pas encore au point désiré pour le bon exercice de la voix comme de l’instrument : et de pareils indices doivent engager à se rechercher jusqu’à ce qu’ils ne se présentent plus. On doit assez juger par là, combien la bonne grace influe dans la parfaite exécution ; aussi en est-elle inséparable. Tout doit également y concourir, la perfection l’occasione, le moindre vice la détruit. Comme la bonne grace est un des principaux objets de la danse, c’est avec raison que le bon Maître n’y occupe d’abord son écolier que des mouvements et des pas jusqu’à ce qu’il en possède tellement la pratique, qu’il ne soit plus obligé d’y porter son attention, lorsqu’il s’agit de lui prescrire les moyen de se procurer cette bonne grace. Il en est de même pour les exercices des armes, de monter à cheval, etc. comme s’en sont expliqués avec moi les plus fameux maîtres de ces Arts. Suivons donc ces modèles que nous avons journellement sous les yeux, figurons-nous bien qu’il en est de la glotte et des autres parties du gosier, qui contribuent à la formation du son, et à la flexibilité de la voix, comme des bras et des jambes pour la danse, et des mains pour les instrumens ; et songeons à procurer à chacune de ces parties, toute la précision et toute la facilité dont elles sont capables dans leurs mouvemens, avant que de nous livrer à une exécution à laquelle elles ne pourroient se prêter dans quelque contrainte ou effort. Cette dernière réflexion est d’une conséquence d’autant plus grande que presqu’aucun de nos Maîtres, soit pour le chant, soit pour les instrumens, n’y a fait attention ; à peine un commençant peut-il entonne quelques sons de suite, qu’on lui enseigne la Musique ; son esprit pour lors occupé de plusieurs objets différens le distrait de ses fonctions naturelles ; plus il sent comment les choses doivent être rendues, plus il s’efforce d’y parvenir ; de là naissent de mauvais sons, des inégalités entr-eux, des défauts de justesse et de flexibilité ; on l’en avertit, à la bonne heure ; mais comment veut-on qu’il puisse s’en corriger, lorsque loin de lui en fournir les moyens, on l’en distrait par des occupations sans nombre ; les clefs, les notes, leurs noms, leur valeur, leur intonation relativement à leurs noms et à leur distance sur une portée de Musique, la mesure, les signes qui en marquent les différences, les soupirs, les points, les diezes, bémols, bécarres et la transposition, voilà les objets dont on l’occupe lorsqu’il s’agit avant tout de former sa voix, d’en tirer le plus beau son possible dans toute son étendue, de la rendre juste, égale, flexible, et de porter son étendue au-delà même des bornes qui semblent d’abord lui être prescrites : d’un autre côté s’agit-il d’un instrument, on n’attend point que les doigts ayent gagné la flexibilité nécessaire pour faire exécuter des airs où l’arrangement, l’ordre, la succession de ces doigts, la mesure, les agrémens, et l’ensemble des deux mains occupent tellement, qu’avec les meilleures dispositions, il est presque impossible de ne pas se contraindre, de ne pas se forcer dans l’exécution ; joignons-y la musique, comme plusieurs le font avant terme, et jugeons après cela, si ce n’est pas un grand hazard, lorsqu’il s’en trouve un entre mille qui réussisse sans quelque défaut. Ce qu’il y a de plus fâcheux dans une pareille méthode, c’est que plus on a de talent, plus elle y est contraire. Ce talent qui suppose le sentiment, nous porte à vouloir exécuter les choses comme nous sentons qu’elles doivent l’être, et n’ayant point encore dans les mouvemens de la glotte, ou des doigts, toute la flexibilité nécessaire, nous faisons des efforts pour cet effet ; ces efforts augmentent de jour en jour, passent en habitude, de telle sorte que nous nous croyons pour lors privés de ce qu’il y a de naturel en nous. L’empressement des écolier et souvent même de leurs parents, ne laisse pas toujours au maître la liberté de les conduire à sa fantaisie, car il peut se trouver des maîtres très capables dans le grand nombre : mais dans ce cas, il vaut mieux, comme cela m’est arrivé, abandonner ceux qui ne se rendent pas à la raison. Le sentiment, organe du bon goût, et l’âme de la belle exécution, ajoûte infiniment à cette exécution, c’est l’appanage ordinaire des esprits vifs : l’indolence au contraire, la nonchalance, la timidité même en font perdre tout le fruit : et c’est ce qu’il faut bien considérer avant que de porter aucun jugement décisif : on confond aisément dans l’exécution, ce qui dépend de la flexibilité des mouvemens, avec ce qui ne dépend que du goût ; les uns expriment le sentiment avec une exécution gênée et forcée, les autres en peuvent faire sentir ce qu’ils sentent eux-même, quoi que leur exécution soit parfaite d’ailleurs, parce qu’un certain fond d’indolence, de nonchalance ou de timidité les retient. S’il est rare de trouve des sujets parfaits dans toute les parties qui concourent à la belle exécution de la Musique, on doit croire que la manière dont on s’y est conduit jusqu’à présent, en est une des principales causes, du moins envers ceux qui promettaient d’ailleurs du côté de la voix et du goût. Combien de belles voix perdent tout leur mérite, faute d’en sçavoir tirer le son, faute d’en sçavoir rendre les sons égaux dans toute son étendue, faute de justesse, faute de flexibilité ? et par conséquent combien de talens enfouis par un seul de ces défauts ? Jean-Philippe Rameau
|
